Un voyage désenchanté à Paris de Bruno Schulz
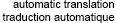

Bruno Schulz w 1942 roku (Wikimedia Commons); Paryż, 1936 rok, widok na Katedrę Notre-Dame, Fotograaf : Poll, Willem van de Auteursrechthebbende : Nationaal Archief Materiaalsoort (Wikimedia Commons)
« Ne m’en veuillez pas d’être parti de Paris sans vous dire au-revoir. Depuis longtemps, j’ai une aversion pour les scènes d’adieu et je les évite autant que je peux. Je suis parti vendredi matin », écrivait Bruno Schulz après son retour à Drohobycz, le 2 septembre 1938. Que s’est-il passé vraiment ? Ces paroles sont-elles sincères où cachent-elles une vérité que Schulz n’avait pas de courage d’avouer ? Nous ne le savons pas et ne le saurons jamais. Ne reste que des conjectures… Une chose est sûre : le voyage à Paris l’a déçu. Pourquoi ? Essayons de le deviner.

Łuk Triumfalny, Paryż 1936, Fotograaf : Poll, Willem van de Auteursrechthebbende : Nationaal Archief Materiaalsoort (Wikimedia Commons)
Originaire d’une ville provinciale de Galicie, près de Cracovie, Drohobycz, Bruno Schulz y passe toute sa vie n’ayant fait que deux voyages à l’étranger, à Stockholm et à Paris. Là, dans sa ville natale, il crée une œuvre très originale d’ampleur universelle, une vision particulière à partir des apparences modestes : la boutique de tissus de son père, magasins de produits coloniaux, rues obscures, terrains vagues, faubourgs, petite gare. Là, Schulz, comme un magicien, fait naître un théâtre d’inspiration biblique, plastique, coloré et plein d’ironie, composé dans un style baroque, inégalable dans la prose polonaise, voire mondiale. Contemporain de Witkiewicz et de Gombrowicz, il forme avec eux le socle de l’avant-garde, réhabilité par un critique Artur Sandauer après sa proscription par les communistes. Tadeusz Kantor s’inspire de son œuvre – caractérisée comme la Réalité du Rang le plus bas -, en transformant l’anecdote d’un de ses récits, Le retraité, pour son inoubliable Classe morte.

Adrian Grycuk, Ławki szkolne i manekiny – fragment stałej ekspozycji do spektaklu “Umarła klasa” Tadeusza Kantora (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie) na wystawie w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 2012 / Wikimedia Commons
Schulz quitte Paris le 26 septembre 1938 et peu après rédige la lettre citée plus haut, destinée à son ami Louis Lille qui a émigré à Paris un an plus tôt, membre d’un groupe d’avant-garde et conservateur du musée juif de Lwów. Il ne reste de ce voyage qu’une facture de l’Hôtel d’Orient, 43 rue de l’Abbé-Grégoire, dans le 6e arrondissement, établi au nom de « Monsieur Schulz » et qui mentionne sept déjeuners.
Apparemment rien n’a répondu aux attentes de Schulz bien qu’il se fût soigneusement préparé à ce voyage en notant les adresses de personnages-clés pour leur présenter ses dessins. Muni d’informations sur les cercles artistiques, il arrive à Paris où l’attend Louis Lille ou bien Georges Rosenberg, frère de Marie Chazen qui lui avait donné maints conseils, tous aussi détaillés qu’inefficaces. Car en août, Paris se dépeuple de ses habitants et si certains quartiers restent animés ce n’est que grâce aux touristes. Hélas, le téléphone de Jan Lechoń ne répond pas. (Ce poète occupe la fonction d’attaché à l’Ambassade Polonaise, juste avant la guerre.) Schulz est fatigué par le voyage après un trajet plus long par l’Italie afin de contourner le IIIe Reich. Il erre dans la ville déserte. Enfin, il rencontre un marchand d’art, André Rotge, qui lui propose une exposition en octobre dans une galerie du Faubourg Saint-Honoré. Mais Schulz n’a pas d’argent pour payer 1600 francs, des frais d’inscription, modeste professeur au gymnasium de province galicienne qu’il est. L’affaire tombe à l’eau.
Que fait-il pendant trois semaines à Paris ? Sans doute va-t-il au Louvre et visite-t-il des galeries d’art. Il achète quelques serviettes de toilette comme cadeau pour ses proches aux Galeries Lafayette. Est-il ému devant les étalages de tissus aux Grands Magasins, tissus dont il a fait une description brillante dans son récit, La morte saison ? Ah, la poésie charnelle des étoffes imprégnées de parfums anciens ! S’exalte-t-il autant que Zola devant des stands modernes à l’exubérance vertigineuse ? Il semble que non, car son imagination ne trouve de tremplin que dans ce qui lui est familier, parmi « des feutres décatis » dans le magasin de son père. Trois semaines, temps assez long pour s’enivrer de nouveautés ou, bien au contraire, pour s’en lasser. Schulz flâne sur les Grands Boulevards. Enfin, il voit l’original de sa « rue des Crocodiles » faite de carton-pâte où tout paraît factice, « suspect et équivoque », sorte de façade qui dissimule une activité louche. La métropole ne peut lui offrir cet aspect fascinant de contrefaçon, car trop brillante, trop « réelle », ville d’étincelants éclats. Partout un luxe anonyme : à la terrasse du Select, au salon de l’aéronautique, sur les trottoirs où se déversent les touristes. Est-il effrayé par cette diversité ? Robes décolletées, silhouettes serpentines, talons, jupes ajustées… Rien ne le ravit, ni les automobiles, ni les restaurants chics, ni les vendeurs ambulants de volailles. L’industrie moderne n’inspire pas son imagination. Il lui préfère son décor provincial un peu kitch, sa propre illusion. Ainsi se brisent ses fantasmes contre cette « vraie ville », courtisane babylonienne répugnante.
Il rentre chez lui fatigué. Cette année a été difficile. Il reste toujours déprimé comme s’il pressentait quelque catastrophe. Thomas Mann ne lui répond toujours pas après son envoi de la traduction d’une de ses nouvelles.

Nagy Gyula, Bazylika Sacré-Coeur, 1938 / Wikimedia Commons
Qu’a-t-il cherché à Paris ? Voulait-il se distraire ? Son rêve de réussir à montrer son œuvre sur une scène internationale a échoué en trois semaines à peine. Ses rêves se sont heurtés contre ce monde « vrai ». Qu’est-ce qui est vrai sinon un fantasme qui occupe toute l’existence, aussi simple soit-elle ?
Bruno Schulz, juif polonais, meurt tragiquement à Drohobycz, le 19 novembre 1942, à l’âge de 50 ans, tué par un Allemand dans un règlement de compte entre deux membres de la Gestapo. Son œuvre tient en deux petits volumes. Mais quelle œuvre exubérante et visionnaire !



Dodaj komentarz